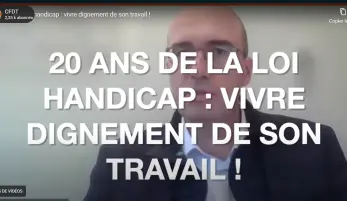
Syndicalisme, politique, indépendance et extrême-droite
Ayant participé au conseil de l'UTI du 12 mars dernier ou ayant lu avec attention le compte rendu et particulièrement les propos tenus lors du tour de table concernant l'actualité revendicative, il nous apparaît nécessaire et utile d'apporter quelques réflexions et de rappeler quelques fondamentaux.
Il nous semble que certains propos reposent sur de grandes confusions. C'est pourquoi nous souhaitons alimenter la réflexion autour de quatre éléments :
- le syndicalisme CFDT est-il politique ? La CFDT fait-elle de la politique ?
- notre rapport au politique,
- indépendance ou neutralité,
- la question de l'extrême droite.
Le syndicalisme CFDT est-il politique ? La CFDT fait-elle de la politique ?
Quand la CFDT s'exprime et participe au débat du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale, allant même jusqu'à proposer des amendements qui sont parfois défendus par des députés lors des débats parlementaires, elle porte l’ambition de renforcer les fondements du système de protection sociale en articulant universalité, personnalisation, solidarité et contributivité. Nous faisons de la politique.
Quand la CFDT revendique la poursuite de la généralisation de la couverture complémentaire en matière de santé en étendant pour toutes les personnes résidant en France, en emploi comme hors emploi, l’adhésion à une complémentaire santé sur la base d’un panier de soin conventionnel adapté, nous faisons de la politique.
Quand l'Union Régionale élabore une contribution à la construction du Plan Régional de Santé pour la Région Grand Est, nous faisons de la politique.
Quand la CFDT affirme qu'il est urgent d’agir pour que chacun puisse développer et maintenir son autonomie le plus longtemps possible, que notre système doit se développer de façon préventive en luttant contre les inégalités notamment territoriales et revendique la mise en place d’une 5ème branche de la sécurité sociale relative à la perte de l’autonomie en clarifiant l’articulation entre le rôle de l’action publique, la place de l’action sociale, notamment départementale, et celle des solidarités familiales, nous faisons de la politique.
Quand la CFDT agit pour garantir l'autonomie de la protection sociale et améliorer son articulation avec l'Etat, nous faisons de la politique.
Quand nous avançons l'objectif d’aider chaque jeune à construire un projet personnel et professionnel et de lever les freins socio-professionnels qu’ils rencontrent trop souvent (logement, santé, mobilité notamment), car nous savons bien que de nombreux jeunes sont obligés de faire face à des discriminations empêchant leurs premiers pas dans la vie active, nous faisons de la politique.
Certes, les manifestions contre la réforme des retraites se sont cristallisées sur la question de l'âge de départ mais la CFDT souhaitait quant à elle, une transformation profonde du système, l’instauration d'un système plus juste et plus lisible qui permettrait, en autres choses, à chacun de choisir plus librement son passage à la retraite. Là encore nous faisons de la politique.
Quand nous voulons :
- mettre la lutte contre les discriminations au coeur de notre combat syndical,
- agir pour l’égalité entre les femmes et les hommes,
- agir pour l’enfance et la petite enfance, un enjeu d’égalité,
- militer pour la mixité sociale,
- garantir aux migrantes et aux migrants l’accès aux droits,
- nous engager pour une éducation émancipatrice, que faisons-nous d'autre si ce n'est de la politique.
L’urgence écologique et climatique ne peut ni ne doit laisser personne indifférent. Elle affecte l’économie, le social, la production de biens et de services, les modes de vie qui doivent donc être pensés ensemble. Cette large réflexion doit être tournée vers l'avenir. Il est indispensable que les militants s’emparent de ces questions qui pèsent sur l’évolution des métiers et des compétences, sur les formations, sur l’organisation du travail ainsi que sur les orientations stratégiques à tous les niveaux.
La CFDT a donc élaboré un « Manifeste pour la transition écologique juste. »
« Si le syndicalisme n’est pas là pour porter le message de la transition écologique juste et embarquer les travailleurs dans cette voie, on prend le risque de continuer d’aborder ces questions-là uniquement sous un prisme défensif. Pour nous, l’idée est de porter cette voix dans le débat public », a déclaré Marylise Léon. Une voix d’autant plus nécessaire que, ces derniers mois, se sont élevés des discours relativistes teintés de climato-scepticisme. N'est-ce pas, là encore, faire de la politique ?
Nous aurions pu prendre bien d'autres sujets. Nous le voyons bien, nous faisons de la politique tous les jours. Oui la CFDT fait de la politique. Oui le syndicalisme CFDT est politique.
Notre rapport au politique
La CFDT porte un syndicalisme de transformation sociale fondé sur son lien avec les travailleurs et ses valeurs.
En conséquence, dans son rapport au politique, elle est :
- Engagée : elle se positionne sur des décisions politiques, décision par décision, en fonction de leur contenu pour plus de progrès social, et non selon la couleur du pouvoir qui les propose.
- Libre : la CFDT reste indépendante de tout parti ou mouvement politique. La CFDT ne soutient aucun parti mais elle défend ses valeurs et son projet de société.
- Elle s’oppose à une vision fantasmée du peuple, monolithique et homogène.
- Elle défend la démocratie, la séparation des pouvoirs, l’État de droit, les valeurs de la République, les corps intermédiaires, et rejette toute forme de discrimination.
Quatre valeurs (émancipation, solidarité, égalité, démocratie) et un principe d'action (l'indépendance) qui font des femmes et des hommes les véritables actrices et acteurs de leurs choix de vie sont essentielles à la définition de ce qu'est la CFDT.
Inscrite dans nos statuts, l’émancipation tant individuelle que collective, reconnaissant à chacun la capacité à se prendre en charge et à agir ensemble, est pour nous un droit inaliénable.
- Pour diriger sa vie.
- Pour imposer le respect de la dignité et de la liberté dans l’entreprise et au sein de la société, et pour satisfaire les besoins de chacun, matériels et intellectuels, dans sa vie professionnelle et personnelle.
Être solidaire, c’est faire le choix de l’entraide pour défendre les droits de tous.
- Pour défendre les droits au sein de l’entreprise, mais aussi entre les salariés et les chômeurs, entre les générations, et plus largement entre les peuples.
- Pour lutter contre toute forme d’exclusion, d’inégalité et de discrimination.
Prôner l'égalité c'est lutter contre toutes les formes d'exclusion, de discrimination, de sexisme, de racisme et de xénophobie.
La démocratie est une valeur qui est l’identité même de la CFDT, elle se trouve d’ailleurs au coeur de notre sigle.
- pour s’exprimer librement et participer à la prise de décision.
- pour être acteur de l’amélioration de ses conditions de travail et de vie, au delà de toute différence d’origine, de nationalité, de confession religieuse et d’opinion.
La CFDT estime indispensable de distinguer ses responsabilités de celles de l’État, des partis politiques et des confessions religieuses,
- pour conserver son autonomie et son sens critique,
- pour impulser ou infléchir les décisions gouvernementales ainsi qu'en ce qui concerne les collectivités territoriales.
Le principe d'action essentiel, c'est l'indépendance.
Cette indépendance va de pair avec l’autonomie des moyens qui nécessite l’adhésion du plus grand nombre de travailleurs à la CFDT, afin que ces derniers contribuent, par leurs cotisations et leur engagement, à la solidité financière et organisationnelle de la CFDT. L'indépendance n'est pas la neutralité.
C'est donc en nous appuyant sur ces quatre valeurs et sur ce principe d'indépendance que la CFDT analyse toute proposition, d'où qu'elle vienne, dès lors qu'elle concerne les travailleurs. Elle le fait, bien évidemment, concernant les partis politiques.
La CFDT ne peut être une spectatrice passive quand se joue l'avenir de notre pays, et que se déterminent les politiques qui seront menées.
Questions d”emplois, de santé, de retraite, d”éducation, de culture, de transport, de logement, défis environnementaux, questions liées à l'égalité femmes-hommes, aux discriminations de toutes natures, à l'accueil des migrants, avenir de l”Europe, défense, coopération internationale, etc.
Bref, tout ce qui fait notre avenir proche, notre futur plus lointain, celui de nos enfants, autant de thèmes et de controverses qui vont alimenter les campagnes électorales de tous niveaux.
La CFDT n”est pas un parti politique.
Profondément républicaine, la CFDT considère de son devoir d'inviter fortement ses adhérents, comme tous les citoyens, à participer à la fois
aux débats et aux scrutins. Mais comment aborder ces questions, participer à ces débats, tout en conservant une forme de distance vis-à-vis des candidats et partis qui se présentent à ces élections ?
C'est en s'appuyant sur les valeurs fondamentales inscrites dans ses statuts et qui sont le fruit de son histoire que la CFDT participe aux campagnes électorales. Parmi celles-ci, l'émancipation est celle qui définit le mieux ce que doit être notre attitude de citoyen. L'émancipation, c”est la capacité pour chaque femme, chaque homme, de prendre en main son propre destin et de contribuer ainsi à l'intérêt collectif.
La CFDT propose à ses adhérents et sympathisants, sans formuler la moindre consigne de vote, d'éclairer leur choix à partir des propositions et revendications qu'elle porte au quotidien.
Pourquoi la CFDT ne peut pas se taire concernant l'extrême-droite ?
Toute démocratie porte en elle le risque de sa propre suppression, c’est-à-dire la menace que, par les urnes, arrive au pouvoir quelqu’un qui confisque le pouvoir. Il suffit, pour cela, qu’un peuple mécontent s’en remette à celui ou celle qui le caresse dans le mauvais sens du poil. L’égalité des droits n’est pas l’égalité des savoirs mais c’est l’égalité des votes, et les innombrables qui, prenant leurs désirs pour des réalités, s’informent comme on s’enferme, sont de la chair à démagogues. Pour qu’un menteur s’empare du pouvoir, il suffit d’amadouer ceux qui confondent, trop vite, la vérité avec ce qui leur fait plaisir. Il suffit, pour que le pire advienne, qu’un filou, une filoute, fasse des promesses intenables à des gens qui, dopés par les réseaux, croient uniquement ce qu’ils espèrent, et leur présente comme autant d’ennemis les méchants qui s’opposent à leurs souhaits. La dictature, c’est la rencontre au sommet d’un flatteur professionnel et d’un électeur hypnotisé.
Nous pensons fermement que la « dédiabolisation » du RN-FN est une filouterie. Pour s'en convaincre il ne faut pas se contenter d'écouter les propos émis dans les médias et sur les réseaux. II faut aussi s'intéresser à l'histoire de ce parti et à l'histoire avec un grand H, lire et notamment analyser son programme.
Prenons l'exemple de l'avenir promis au syndicalisme par le FN-RN.
« Nous travaillons toujours en interne à la libéralisation syndicale », confessait un membre du RN au journal L’Opinion. Officiellement, il s’agit de lutter contre la « crise des syndicats ». En vérité, il s’agit de casser le monopole des syndicats jugés « proches de la gauche » au profit de nouveaux organismes plus identitaires. Le point 10 du programme, prévoit que chacun puisse créer son syndicat et se présenter dès le premier tour aux élections professionnelles, ce qui n’est possible aujourd’hui que pour les organisations reconnues comme représentatives. Cette « libéralisation » permettrait de contourner une décision de justice de 1998 ayant interdit les syndicats FN, tournés vers la préférence nationale. Qu’on ne s’y trompe pas ; c’est la porte ouverte à toutes les dérives, à des organismes politisés, des jaunes (à la botte de l’employeur) ou à des syndicats
communautaristes. C'est même le retour possible des syndicats ou chambres corporatistes (regroupant patrons et salariés), comme ce fut le cas avec la charte du travail... en 1941 sous le régime pétainiste.
Autrement dit, il s'agit de la mort programmée du syndicalisme indépendant, du syndicalisme de transformation sociale. Il n'y a pas de démocratie sans corps intermédiaires. Tous les faits montrent que l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir abîmerait durablement la démocratie. Sur le site de la confédération, on trouve un dossier « Repères » On ne débat pas avec l'extrême droite, on la combat. Oui mais pour la combattre il faut la connaître dans sa globalité.
Depuis quelques années, les médias désignent de plus en plus les groupes identitaires, nationalistes, comme appartenant à « l'ultra-droite », alors qu’ils étaient auparavant englobés dans le vocable « extrême droite ». Y aurait-il une nuance objective entre les deux expressions ?
L'expression est désormais tombée dans le langage médiatique. De cette façon, l'ultradroite est la seule à être diabolisée. Le diable est enlevé de l'extrême-droite. Par ce tour de passe-passe, l'extrême-droite est « dédiabolisée » et devient alors « fréquentable ».
L’utilisation abusive du terme ultra-droite pour désigner ce qui se trouverait à droite du Rassemblement national omet le fait que la « mouvance électoraliste », le RN, peut être tout autant mise en cause dans ses thèses comme dans ses violences.
Il faut donc pousser l'analyse.
Il convient de regarder comment la science politique a historiquement défini l'appartenance à l'extrême droite. Lors des deux dernières élections présidentielles, la CFDT a appelé à faire barrage à l'extrême droite. Rappelons que cette « consigne » de vote n'a concerné que le second
tour d'un scrutin à deux tours. Nous respectons la différence entre le citoyen dans l'isoloir et le militant CFDT sur son lieu de travail. La responsabilité dans chaque cas n'est pas de même nature. Alors pourquoi avoir appeler à faire barrage ? Nous n'y aurions pas été contraints si le combat contre la pénétration des idées d'extrême droite parmi les salariés était suffisant à les faire reculer dans les entreprises et les services.
La pénétration des idées d'extrême droite parmi les salariés s’appuie sur des difficultés rencontrées au quotidien dans les entreprises ou les services. C'est, par exemple, l'embauche de salariés communautaires ou extra communautaires plus corvéables et que le patronat utilise plus ou moins à sa convenance. Il est plus facile alors de revendiquer la suppression du problème que d'agir pour l'égalité des des droits : supprimer le problème au lieu de le traiter.
Pour conclure
Il nous apparaît nécessaire de réfléchir collectivement à tous les niveaux de l'organisation à la Reconstruction d'un cycle de formation initiale et continue des responsables, de la section syndicale aux structures fédératives. Il s'agit d'armer les militants de base comme les cadres de l'organisation.
Ce cycle de formation devra :
- s'appuyer sur un socle de valeurs,
- prendre en compte les questions transversales, économiques, sociales, environnementales,
- partager les problèmes rencontrés par les militants et y répondre,
- apprendre à débattre dans un collectif.
Nous appelons à redéfinir la formation politique des responsables.
